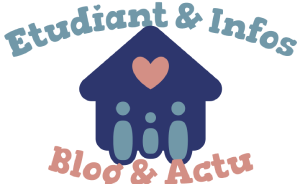Selon Nouriel Roubini, ancien économiste senior du Council of Economic Advisor sous l’administration Clinton, « les États-Unis sont maintenant effectivement entrés dans une sérieuse et douloureuse récession. Le débat n’est plus de savoir si l’économie aura un ‘soft landing’ ou un ‘hard landing’, mais plutôt de savoir à quel point l’atterrissage sera dur ». Selon l’auteur, la situation est sérieuse : « la pire chute du marché immobilier, qui continue de s’effondrer ; un crash sévère de liquidités et de crédit dans les marchés financiers bien pire que celui de l’été dernier ; les prix élevés du pétrole et de l’essence à la pompe ; un déclin de l’investissement en capital dans le secteur corporatif ; un marché de l’emploi qui fléchit avec trop peu d’emplois créés et un chômage à la hausse ; et enfin, la difficulté croissante d’accès au crédit pour les consommateurs causée par la chute de la valeur de leur maison [qui sert normalement de garantie d’emprunt] ». Comme la consommation privée aux États-Unis compte pour 70% du PIB, Roubini conclut que les Américains sont déjà en récession. Une triple crise Dès août 2007, des symptômes concrets de la première crise, celle du crédit, se font sentir lorsqu’une quantité importante de ménages américains fait simultanément défaut sur des paiements d’hypothèques contractées quelques années auparavant en vue de réaliser le rêve de devenir propriétaire. Les conséquences sont prévisibles. Les ménages ne remboursant pas leurs prêts, leurs institutions financières respectives se sont automatiquement retrouvées dans l’impossibilité de rembourser à leur tour… d’autres institutions financières. Ce manque de liquidité a contaminé, dans un premier temps, tous les marchés financiers de la planète ayant investi dans le tristement célèbre marché des subprimes (prêts hypothécaires à haut risque). Dans un deuxième temps, aux États-Unis, d’autres marchés (les crédits à la consommation, les prêts étudiants, les prêts automobiles, etc.) furent également atteints. Devant les pertes colossales qui se dessinaient, un vent de panique généralisé s’est alors emparé des marchés boursiers sur la planète. Les banques centrales sont d’abord venues à la rescousse en injectant des milliards sur les marchés. Quant à l’économie réelle, inutile de mentionner qu’elle a essuyé de lourdes pertes. En effet, les derniers chiffres parlent de 3,8 millions de ménages américains aux maisons confisquées, faillites personnelles, suicides de personnes ruinées, faillites d’entreprises de construction et pertes d’emplois. Sur ce dernier point, le Center for Economic and Policy Research nous apprenait en janvier que si les États-Unis subissent actuellement une récession « moyenne », les pertes d’emplois à l’horizon de 2010 se chiffreraient à 3,2 millions. Si la récession s’avérait plus sévère, on atteindrait alors l’impressionnant chiffre de 5,8 millions d’emplois perdus d’ici 2011. Comme la consommation américaine maintient en vie une économie mondiale en manque de demande, on peut s’inquiéter des conséquences qu’entraînerait un ralentissement sévère de l’emploi et de la consommation aux États-Unis. Comment en est-on arrivé là ? Les sociétés financières qui ont octroyé les prêts, afin de partager les hauts risques encourus, ont transformé leurs créances en titres de dettes (titrisation). Cette pratique leur permettait de revendre ces créances aux grandes institutions financières à travers des paniers de titres. Ces créances titrisées, incluses dans des portefeuilles de créances diverses (crédits immobiliers, créances bancaires, crédit à la consommation, etc.) appelés CDO (Collateralized Debt Obligation), comportaient dès lors des degrés de risque variés et acceptables relativement au rendement. Les tranches supérieures des CDO obtenaient d’ailleurs la note maximale décernée par les agences de notation. Qui plus est, ces titres étaient facilement négociables sur les marchés financiers. Pourvu que tous les risques ne se matérialisent pas en même temps et que le marché demeure en hausse, pas de problème. La nature et la provenance exactes des titres, ces produits financiers dérivés hautement sophistiqués à l’intérieur du panier, suscitaient (à tord) peu d’inquiétudes. Cette opération de revente de titre, et donc de partage de risque, s’est dissipée et multipliée dans les marchés financiers. Or, malheureusement (ou heureusement), l’hypothèse écartée dès le départ par les bonzes de Wall Street se matérialise : trop de ménages deviennent incapables de rembourser leurs prêts en même temps qu’explose la bulle immobilière américaine qui fait chuter brutalement les prix des maisons. Par conséquent, les titres dérivés des crédits hypothécaires à haut risque (subprimes) ne valent plus rien. Le problème majeur est que la titrisation est à ce point complexe qu’elle rend impossible la traçabilité de ces « cellules cancéreuses » : « on ne sait pas où sont les pertes, ni si elles ont toutes été prises en compte », affirme Florence Pisani, économiste à Dexia-AM. Dès lors, les banques, incapables de localiser les virus, arrêtent de se prêter entre elles. D’où la deuxième crise : celle de confiance. À cela s’ajoute le fait que les organismes de crédits hypothécaires ont prêté à long terme à leurs clients résidentiels tout en contractant des prêts à court terme auprès d’institutions financières. Ainsi, le défaut de paiement des ménages a rendu les sociétés de crédits hypothécaires incapables de rembourser leurs prêts à court terme. Raison de plus pour un arrêt des prêts interbancaires. Aux États-Unis, 84 sociétés de crédits hypothécaires ont fait faillite ou cessé au moins partiellement leurs activités au cours des trois premiers trimestres de 2007, contre seulement 17 sur toute l’année 2006. L’arrêt du flux monétaire interbancaire entraîne automatiquement un manque d’argent dans l’économie. D’où la troisième crise : celle de liquidité. L’ultra financiarisation de l’économie Cette crise n’est pas un accident de parcours ni une conséquence entièrement naturelle de l’évolution de l’économie. Il s’agit d’un glissement graduel, mais voulu du système économique mondial vers un système financiarisé à outrance. La combinaison d’une surproduction mondiale permise par les reconstructions d’après-guerre, la crise pétrolière des années 70, celle de la dette de la décennie suivante, la récession économique américaine et les pressions inflationnistes résultent en une impossibilité de générer des profits substantiels pour les entreprises dans une économie basée sur la production de biens et de services. La solution s’avérait évidente : au lieu de créer de la valeur à travers la production de nouveaux biens et services, le système économique allait devoir vivre un glissement vers le secteur financier, où la création de valeur économique n’a pas besoin d’être liée à l’économie réelle. Cette situation a entraîné, à partir du début des années 1980, une révision des systèmes nationaux de contrôle de capitaux hérités de Bretton Woods permettant ainsi une libéralisation en force du système financier au détriment de l’économie réelle. Ces politiques nationales ont rapidement mené à une déréglementation et dérégulation sélective du système financier international (notons qu’il demeure tout de même le marché le plus régulé), dont l’explosion du marché ne devait pas tarder. La majorité des États abandonnèrent les barrières traditionnelles entre les divers secteurs financiers (dépôts et épargne, investissement et assurance, fonds de placement et fonds de pension). Ensuite, la libéralisation financière tant espérée par les intérêts financiers rendit à nouveau possibles les flux financiers spéculatifs internationaux, les permettant de parcourir le globe sans entrave à la recherche de création de valeur immatérielle. Mais surtout, c’est la montée en puissance de l’ingénierie financière, appuyée sur le déploiement généralisé des technologies dans les années 1980 et alimentée par la politique de bas taux monétaires d’Alan Greenspan durant les années 1990, qui viendra mettre en place les éléments structurants de la crise. Ainsi le développement des produits dérivés, des techniques sophistiquées de sécuritisation (transformation de dettes en actifs divisés et vendus sur le marché financier) et leur déploiement à l’ensemble du secteur financier international ont-ils graduellement développé un monstre financier global forcé d’imaginer d’année en année de nouvelles méthodes pour créer de la valeur artificielle. Vers une crise mondiale ? Les crises actuelles du crédit, de la confiance et de la liquidité ne font que traduire l’aboutissement d’un processus de transformations financières, apparemment localisé aux États-Unis. Le système américain ne serait pourtant que l’arbre qui cache la forêt. En effet, l’aspect financier de cette crise n’a de local que le premier acte d’emprunt du ménage auprès de l’organisme de crédits hypothécaires. À partir du moment où entre en scène la titrisation, la face globale du système financier se révèle, car tout « investisseur » sur le globe peut dès lors, souvent sans en être conscient, se porter acquéreur d’un titre issu des subprimes. Les États-Unis ne sont que l’épicentre d’une crise mondiale. Si l’ampleur de la récession américaine prédite plus haut vient à se matérialiser, le degré d’imbrication des marchés financiers justifie nos craintes d’une crise majeure. Dans la foulée des pertes titanesques encaissées par les grandes banques, on retiendra celles de Merrill Lynch, Citigroup, UBS et HSBC. Celles-là, parmi bien d’autres en désarroi de liquidité, ont dû recourir aux fonds souverains d’Abu Dhabi, d’Arabie Saoudite, du Koweït, de Chine, de Singapour et de Corée du Sud pour remplir leurs coffres. Certes, à court terme, ces joueurs rassurent et soulagent, mais plusieurs se questionnent sur les conséquences de cette perte de souveraineté des banques occidentales au profit des fonds souverains de riches pays en développement. Y a-t-il un risque de voir ces États utiliser leurs nouveaux leviers financiers comme arme de politique étrangère ? Cette possibilité n’est certainement pas exclue, ni improbable. À cela s’ajoutent les déboires de l’économie américaine, qui constitue le « consommateur de dernier recours » pour l’écoulement d’une partie de la production mondiale en manque de demande. Si l’on conjugue les structures et les outils sophistiqués mis en place dans le secteur financier, la politique monétaire américaine aveuglée par une illusoire relance économique, un dollar faible et la baisse de la consommation américaine, on risque de voir, à terme, un rattrapage brutal et inévitable d’une économie mondiale financiarisée par l’économie réelle. Concrètement, cela se traduira par un portrait assez sombre du social : mises à pied massives, création d’emplois stagnante, baisses des salaires, baisses de l’investissement, etc. Reste à espérer que cette crise constituera une profonde prise de conscience et provoquera un retour à une économie internationale misant cette fois sur la création de richesse sociale et réelle.
Financiarisation et crise financière